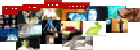Veuillez patienter pendant que nous traitons votre requête

Chronophobia: On Time in the Arts of the 1960s
Lee, Pamela, M. — Chronophobia: on time in the arts of the 1960s. — Cambridge : MIT Press, 2004. — 368 p. — Comprend un index.
Dans cet essai, Pamela M. Lee aborde l’historiographie de l’art des années 1960, en mettant l’accent sur une préoccupation récurrente des artistes et des critiques pour la dimension temporelle des œuvres. Lee fait l’économie d’une recension exhaustive de travaux qui révèlent cette dimension dans une optique pragmatique. L’auteur souligne plutôt les liens entre la réception de ces pratiques artistiques et l’obsession populaire pour l’anticipation scientifique à cette époque (les futurologues, l’utopie du village global, la cybernétique). Son ouvrage ne fait donc pas office d’histoire des pratiques utilisant les médias ou les composants technologiques dans les années 1960, mais tente des rapprochements entre des théories sur les médias et sur l’art de cette décennie laboratoire.
Dans le chapitre d’introduction, « Eros and Civilisation », Lee fait état de la nature problématique des collaborations entre artistes et représentants des sphères technologiques et scientifiques à la fin des années 1960. Ces échanges sont contemporains d’un débat polarisé sur l’omniprésence de la technologie dans la vie quotidienne. Herbert Marcuse constitue la figure de proue de cette faction théorique qui décrie l’émergence d’une société dominée par la technique. En retour, des projets contemporains à ce discours comme le « Art and Technology Program » du Los Angeles County Museum of Art de 1966 et le collectif de parrainage « Experiments in Art and Technology », né la même année, semblent paver la voie à un échange productif entre les sphères de l’industrie et les artistes. Or, selon les analyses qui suivent, ces échanges s’avèrent conflictuels dans les deux camps. Lee avance que ce malentendu est tributaire du contexte d’émergence des pratiques artistiques oscillant entre une critique radicale du contexte médiatique et l’emploi de la technologie comme outil neutre de créativité.
Dans le premier chapitre, « Presentness Is Grace », Lee expose la thèse constituant le filon de son ouvrage. Elle relève une phobie du temps ou de la durée dans la réception des œuvres des années 1960, en particulier chez des critiques modernistes de la génération précédente comme Michael Fried. Pour ces critiques qui refusent en bloc les propositions du minimalisme et de l’art conceptuel, le présent constitue le seul temps possible de l’expérience des œuvres et procède donc d’une négation à la fois de l’histoire et du nouveau contexte médiatique de l’époque. L’auteur fait état d’un dépassement de ce discours dans l’appropriation de concepts issus de la cybernétique par les artistes alors émergents. Elle recense les discours qui servent d’assise théorique aux pratiques dont la visée sera de mettre en parallèle divers systèmes (naturels, sociaux, technologiques) avec les œuvres elles-mêmes (Hans Haacke est l’un des représentants de cette démarche). Lee réfléchit également sur les liens qui s’établissent alors entre la définition des médiums artistiques et l’émergence des « nouveaux médias ». Le deuxième chapitre, « Study for the End of the World », se rattache au corpus de l’art cinétique et plus particulièrement au travail de Jean Tinguely et de Pol Burry, dont les œuvres respectives constituent les deux pôles de ce mouvement. Lee souligne que l’art cinétique des années 1960 rejoue l’esthétique de l’âge technologique des avant-gardes historiques à l’ère des communications de masse. Il s’agit cependant d’un retour nécessaire selon l’auteur. Avec ses sculptures autodestructrices, Tinguely crée des événements où les objets sont simultanément mis en spectacle et annihilés, souvent devant des caméras de télévision. Lee aborde ici l’échec comme un phénomène productif qui suggère une critique de l’efficacité de la technologie dans les années 1960. Par contraste, chez Burry, le mouvement de l’objet se déploie de façon presque imperceptible, la lenteur du dispositif devenant une autre proposition d’appréhension de l’environnement perceptif. Le troisième chapitre, « Bridget Riley’s Eye-Body Problem », constitue une analyse du contexte de réception de la peinture Op de Bridget Riley à la fois par les critiques d’art et les médias de masse. Cette peinture génère des lectures contradictoires où le corps de Riley et sa féminité deviennent l’enjeu de l’œuvre plutôt que les effets optiques ou la rigueur scientifique de sa démarche. À titre de contre-exemple, Lee évoque le travail en performance de Carolee Schneemann qui résout la problématique de l’objectification du corps de l’artiste dans un environnement technologique, en proposant une expérience cinesthésique au spectateur. Le quatrième chapitre, « Ultramoderne: Or, How George Kubler Stole the Time in Sixties Art », commente le recyclage des thèses conservatrices de l’historien d’art George Kubler par l’artiste Robert Smithson dans le but de dépasser le déterminisme de l’idéologie moderniste. Lee affirme que ce détour par les vues transhistoriques de Kubler sur l’art permet à Smithson d’intégrer des concepts issus de la cybernétique dans sa démarche. Ce chapitre met avant tout l’accent sur le mode de circulation des discours d’un champ à l’autre (de l’art vers la science et inversement). Le cinquième chapitre, « The Bad Infinity: The longue durée », aborde de nouveau la dimension temporelle des pratiques artistiques, mais expose ici le temps historique tel qu’il se déploie métaphoriquement dans les œuvres. Lee aborde, entre autres, le décalage entre les discours sur l’an 2000 des années soixante et les hantises millénaristes récentes. Elle commente la popularité des ouvrages de futurologues qui prolifèrent à cette époque et conclut en évoquant deux utilisations du concept de futur dans le champ artistique. Le livre Art and the Future de Douglas Davis, publié en 1973, présente les œuvres utilisant des composants technologiques comme une anticipation à la fois de l’art et de la société à venir. Lee critique ensuite cette approche qui constitue une réactivation de la notion d’avant-garde. Elle y oppose la durée excessive des films d’Andy Warhol et la recension minutieuse du quotidien dans le travail d’On Kawara, amorcée dans les années 1960 et poursuivie jusqu’à ce jour, qui inscrit l’expérience de l’œuvre elle-même dans le futur.
Dans cet essai, Pamela M. Lee aborde l’historiographie de l’art des années 1960, en mettant l’accent sur une préoccupation récurrente des artistes et des critiques pour la dimension temporelle des œuvres. Lee fait l’économie d’une recension exhaustive de travaux qui révèlent cette dimension dans une optique pragmatique. L’auteur souligne plutôt les liens entre la réception de ces pratiques artistiques et l’obsession populaire pour l’anticipation scientifique à cette époque (les futurologues, l’utopie du village global, la cybernétique). Son ouvrage ne fait donc pas office d’histoire des pratiques utilisant les médias ou les composants technologiques dans les années 1960, mais tente des rapprochements entre des théories sur les médias et sur l’art de cette décennie laboratoire.
Dans le chapitre d’introduction, « Eros and Civilisation », Lee fait état de la nature problématique des collaborations entre artistes et représentants des sphères technologiques et scientifiques à la fin des années 1960. Ces échanges sont contemporains d’un débat polarisé sur l’omniprésence de la technologie dans la vie quotidienne. Herbert Marcuse constitue la figure de proue de cette faction théorique qui décrie l’émergence d’une société dominée par la technique. En retour, des projets contemporains à ce discours comme le « Art and Technology Program » du Los Angeles County Museum of Art de 1966 et le collectif de parrainage « Experiments in Art and Technology », né la même année, semblent paver la voie à un échange productif entre les sphères de l’industrie et les artistes. Or, selon les analyses qui suivent, ces échanges s’avèrent conflictuels dans les deux camps. Lee avance que ce malentendu est tributaire du contexte d’émergence des pratiques artistiques oscillant entre une critique radicale du contexte médiatique et l’emploi de la technologie comme outil neutre de créativité.
Dans le premier chapitre, « Presentness Is Grace », Lee expose la thèse constituant le filon de son ouvrage. Elle relève une phobie du temps ou de la durée dans la réception des œuvres des années 1960, en particulier chez des critiques modernistes de la génération précédente comme Michael Fried. Pour ces critiques qui refusent en bloc les propositions du minimalisme et de l’art conceptuel, le présent constitue le seul temps possible de l’expérience des œuvres et procède donc d’une négation à la fois de l’histoire et du nouveau contexte médiatique de l’époque. L’auteur fait état d’un dépassement de ce discours dans l’appropriation de concepts issus de la cybernétique par les artistes alors émergents. Elle recense les discours qui servent d’assise théorique aux pratiques dont la visée sera de mettre en parallèle divers systèmes (naturels, sociaux, technologiques) avec les œuvres elles-mêmes (Hans Haacke est l’un des représentants de cette démarche). Lee réfléchit également sur les liens qui s’établissent alors entre la définition des médiums artistiques et l’émergence des « nouveaux médias ». Le deuxième chapitre, « Study for the End of the World », se rattache au corpus de l’art cinétique et plus particulièrement au travail de Jean Tinguely et de Pol Burry, dont les œuvres respectives constituent les deux pôles de ce mouvement. Lee souligne que l’art cinétique des années 1960 rejoue l’esthétique de l’âge technologique des avant-gardes historiques à l’ère des communications de masse. Il s’agit cependant d’un retour nécessaire selon l’auteur. Avec ses sculptures autodestructrices, Tinguely crée des événements où les objets sont simultanément mis en spectacle et annihilés, souvent devant des caméras de télévision. Lee aborde ici l’échec comme un phénomène productif qui suggère une critique de l’efficacité de la technologie dans les années 1960. Par contraste, chez Burry, le mouvement de l’objet se déploie de façon presque imperceptible, la lenteur du dispositif devenant une autre proposition d’appréhension de l’environnement perceptif. Le troisième chapitre, « Bridget Riley’s Eye-Body Problem », constitue une analyse du contexte de réception de la peinture Op de Bridget Riley à la fois par les critiques d’art et les médias de masse. Cette peinture génère des lectures contradictoires où le corps de Riley et sa féminité deviennent l’enjeu de l’œuvre plutôt que les effets optiques ou la rigueur scientifique de sa démarche. À titre de contre-exemple, Lee évoque le travail en performance de Carolee Schneemann qui résout la problématique de l’objectification du corps de l’artiste dans un environnement technologique, en proposant une expérience cinesthésique au spectateur. Le quatrième chapitre, « Ultramoderne: Or, How George Kubler Stole the Time in Sixties Art », commente le recyclage des thèses conservatrices de l’historien d’art George Kubler par l’artiste Robert Smithson dans le but de dépasser le déterminisme de l’idéologie moderniste. Lee affirme que ce détour par les vues transhistoriques de Kubler sur l’art permet à Smithson d’intégrer des concepts issus de la cybernétique dans sa démarche. Ce chapitre met avant tout l’accent sur le mode de circulation des discours d’un champ à l’autre (de l’art vers la science et inversement). Le cinquième chapitre, « The Bad Infinity: The longue durée », aborde de nouveau la dimension temporelle des pratiques artistiques, mais expose ici le temps historique tel qu’il se déploie métaphoriquement dans les œuvres. Lee aborde, entre autres, le décalage entre les discours sur l’an 2000 des années soixante et les hantises millénaristes récentes. Elle commente la popularité des ouvrages de futurologues qui prolifèrent à cette époque et conclut en évoquant deux utilisations du concept de futur dans le champ artistique. Le livre Art and the Future de Douglas Davis, publié en 1973, présente les œuvres utilisant des composants technologiques comme une anticipation à la fois de l’art et de la société à venir. Lee critique ensuite cette approche qui constitue une réactivation de la notion d’avant-garde. Elle y oppose la durée excessive des films d’Andy Warhol et la recension minutieuse du quotidien dans le travail d’On Kawara, amorcée dans les années 1960 et poursuivie jusqu’à ce jour, qui inscrit l’expérience de l’œuvre elle-même dans le futur.
Vincent Bonin © 2004 FDL