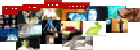Un art contemporain numérique
Conservation, diffusion et marché
Emanuele Quinz
L’art numérique, un art contemporain ?
Transcription de la conférence donnée au Centre Canadien d’Architecture,
Colloque Molior 15-24 novembre 2016.
I.
Encore, encore... Toujours la même question, la vexata quaestio du rapport tourmenté entre art numérique et art contemporain, qui est au fond la question de la définition d’un art numérique, dont on n’a pas arrêté de proposer d’autres appellations – new media art, art digital, technologique, informatique, médiatique –, toujours avec des flottements entre pluriel ou singulier, versus l’art contemporain (ici pas de pluriel, bien évidemment)...
Alors pourquoi encore cette question? D’abord, parce qu’elle n’est pas résolue. Mais on peut se demander si elle le sera un jour, ou s’il faut vraiment la résoudre.
Pour ce qui me concerne, j’ai deux mobiles qui me conduisent à me reposer cette question : un plus théorique et un plus contingent, un plus général et un plus personnel.
Depuis toujours, je m’intéresse à la question des frontières entre les disciplines artistiques – inter/trans/disciplinaire. Ma spécialité en tant qu’historien de l’art est d’explorer ces frontières – pour cela, je me définis parfois comme historien des arts.
L’artiste conceptuel Mel Bochner a produit dans les années 1970 une œuvre qui s’appelle Theory of Boundaries. Or, dans sa condition actuelle, post-conceptuelle (après le tournant conceptuel qui a impulsé un virage irréversible) et post-médiale, l’art se définit justement comme une theory of boundaries, comme une théorie – et une pratique – des frontières : les définitions disciplinaires sont tiraillées par des tensions épistémologiques, par des perspectives descriptives et prescriptives qui n’arrêtent pas de se reconfigurer. Une théorie des frontières, mais aussi un théâtre des frontières, où s’affrontent des courants historiques, culturels : un horizon dynamique – relationnel, car il est constitué de connexions, mais surtout positionnel, car il est composé d’un jeu de polarisations, de vectorialisations. De positions qui sont toujours des oppositions. Si le côté positionnel indique l’orientation directionnelle, le côté relationnel souligne la réversibilité des vecteurs. Il s’agit d’un point très important, on y reviendra plus tard.
Si l’on considère le système des arts ou l’art in the extended field – comme il semble se configurer à partir des années 70 –, on ne peut le voir que comme un théâtre d’opérations, caractérisé par des affrontements et des déplacements de bords territoriaux. C’est au moins à cette figuration que m’ont conduit mes recherches des dernières années, que j’ai envisagées comme des excursions, des explorations des zones de frontière disciplinaires.
Mon deuxième mobile est plus personnel. Il est lié à l’histoire de ces explorations, qui ont commencé notamment avec la fondation d’anomos, association fondée à Bolzano, en Italie, et à Paris, en 1995, et qui a été active jusqu’en 2011. Conçue comme un observatoire de l’impact des médias numériques sur la culture et la création contemporaines, anomos a rassemblé un réseau international d’artistes, chercheurs, compositeurs, chorégraphes, architectes et informaticiens, et a été à l’origine de colloques, workshops, conférences (comme le cycle « Face au présent », qui s’est tenu de 1999 à 2007 dans des lieux comme la Maison Européenne de la Photographie et le Centre Pompidou à Paris), ainsi que de publications (comme la revue-collection d’ouvrages Anomalie, 2000-2007) (1) –, mais aussi du Laboratoire Médiadanse, fondé à l’Université Paris 8 avec Armando Menicacci.
La réflexion que je vous propose aujourd’hui se déroulera à partir de ces deux registres : d’un côté, la perspective d’une recherche théorique plus générale, de l’autre celle d’une quête plus personnelle.
Dans le recueil Le cercle invisible (2), dont l’édition française va paraître au début de 2017 aux Presses du réel, j’ai rassemblé tous les textes où j’aborde la question de la technologie dans l’art. Il s’agit, entre autres, des préfaces des volumes d’Anomalie que j’ai dirigés et du catalogue de l’exposition Invisible, dont j’ai assuré le commissariat en 2004. Tous ces textes, écrits dans des occasions spécifiques, ont été non seulement révisés, mais réécrits. Parfois, avec le recul, les conclusions ont été modifiées, parfois même renversées. J’ai envisagé ce travail de réécriture comme un travail de vérification des hypothèses émises à l’époque, comme une remise en question des positions. Ce travail, parfois tourmenté, est raconté dans un dialogue fictif qui clôt le volume et qui s’intitule Journal d’un apostat.
Le fil rouge de tous ces écrits était la définition d’une esthétique de l’interactivité dans le contexte d’un art en transformation. Quinze ans plus tard, en prenant progressivement du recul, en essayant de leur donner une épaisseur historique, j’en suis venu à interroger davantage les liens entre les expérimentations, à la fois théoriques et pratiques, des années 1990 – au moment où le milieu de l’art faisait face à ce que, à l’époque, Pierre Lévy (premier président d’anomos) avait appelé « le déluge numérique » –, et d’autres pulsions plus anciennes – comme les tendances anti-objectuelles qui poussaient vers les paradigmes de l’environnement, de la participation et de la relation. Il me semblait impératif de réinscrire les expérimentations technologiques dans un contexte artistique et culturel élargi.
II.
Mais venons-en à notre propos. En préparant cette conférence, j’ai décidé de ne pas partir, comme on l’attendrait, des actes de fondation de ce qu’on appelle « art numérique », de l’identification d’un moment d’éclosion, ou d’un geste de scission séminale qui aurait séparé un fragment du corps de l’art, pour fonder un nouveau corpus. Au contraire, j’ai décidé de partir des déclarations de mort, de proposer de faire plus qu’une généalogie : une autopsie – ou du moins, de tenter de lister quelques diagnostics sur la fin, la non-existence, le déclin de l’art numérique.
La déclaration qui a produit pour moi un déclic a été prononcée par Bernard Stiegler, auteur de la trilogie La technique et le temps, à l’époque directeur de l’IRCAM. Le 8 février 2004, lors d’une conférence au Centre Pompidou, évoquant les échos contemporains de l’exposition historique Les Immatériaux, conçue par Jean-François Lyotard, Stiegler affirmait, péremptoire : « L’art numérique n’existe pas, il n’a jamais existé. »
Voilà, le mot avait été lâché – et paradoxalement, d’entendre ce mot ne m’a pas attristé ou irrité, mais quelque part soulagé. Avec anomos, nous avons été engagés pendant plus de 10 ans dans une sorte de campagne de « sensibilisation » aux usages des technologies dans des contextes réfractaires de l’art – notamment dans le domaine de la danse. On militait pour l’exploration des potentiels des technologies numériques, pour expérimenter de nouvelles interactions entre les langages de l’art, pour créer des associations inédites entre image et son, pour sortir du cadre, pour impliquer le public... Pourtant, avec le temps, nous avions commencé à sentir que la définition d’art numérique était trop étroite. Comme une provocation, je déclarais à mes amis que le livre sur lequel je travaillais à l’époque, et qui devait contenir mon fin mot sur la question, allait s’appeler Contre l’art numérique.
Autour de nous, d’autres acteurs importants, impliqués dans la même démarche, partageaient le même malaise – je pense notamment à Philippe Franck, qui a écrit un article « Art sans Frontières », dans la revue Mouvement, en 2006, ou à Grégory Chatonsky, qui a parlé de « l’indifférence de l’art numérique ». Je le cite : « (...) nous nous sommes toujours sentis mal à l’aise face à cette notion, à ce territoire et à ce ghetto. Non pas parce qu’il aurait pu être remplacé par un autre mot, une formule plus juste, mais plutôt parce que face à tout mot qui donne une définition nous sommes dans une position de résistance. Et au-delà même de cet affect, il y a sans doute une raison structurelle. C’est que l’art numérique n’est pas l’art vidéo, ni l’art photographique, ni l’art cinématographique, etc. (...) Or avec le numérique, le champ d’application est beaucoup plus grand, l’ordinateur touche en effet l’ensemble des sphères de la vie, le privé comme (le) public, l’intime comme le collectif, le loisir comme le travail. Quand quelqu’un sort de son travail, qu’il rentre chez lui, que fait-il? Il allume son ordinateur, un autre ordinateur à son bureau ayant été éteint, peut-être que dans le transport le ramenant chez lui a-t-il (sic) utilisé son smartphone pour naviguer sur Internet. Ce flux continu s’applique à la temporalité elle-même. Le numérique n’est donc pas dans le champ social un médium comme un autre, il opère une forme de totalisation, d’intégration des différences. De la sorte, il semble peu probable que comme médium artistique il reste indifférent à cette nature et on voit combien il faut alors bouleverser nos habitudes et nos cadres d’analyses esthétiques pour se hisser à la hauteur de cette transformation (3) ».
Ce texte est intéressant pour notre réflexion. Sa conclusion, qui est celle de beaucoup d’analystes, est qu’il faut voir le numérique non pas comme un médium, qui se rangerait à côté de l’art vidéo, du cinéma expérimental, de l’art audio, mais comme « un monde, un monde qui décatégorise les regroupements classiques. Ainsi l’art numérique n’est jamais là où on l’attend. Il se déplace, il est indifférencié parce que dans la société il est un peu partout (4) ».
Alors, la déclaration de Stiegler en 2004 ne nous a pas troublé, bien au contraire.
Plus tard, dans son texte « L’art numérique n’a pas eu lieu » (2013), Patrice Maniglier reprend les mêmes arguments que Chatonsky : « Cela semble désormais un fait historique acquis : l’art numérique n’a pas eu lieu. On en avait pourtant annoncé la venue imminente en grande pompe. Comment en aurait-il été autrement? Une nouvelle technologie apparaissait, d’une puissance toute singulière, elle ne pouvait laisser les artistes indifférents. Ces bricoleurs insatiables n’allaient pas manquer d’investir ce médium comme ils avaient investi le cinématographe, la vidéo, la radio et même la télé. On l’attendit. On l’attend encore. Les sceptiques demandent : où sont les chefs-d’œuvre de l’art numérique? Les croyants s’agacent, s’impatientent, soupçonnent les sceptiques d’être victimes de l’éternel biais réactionnaire, cet esprit qui toujours nie et qui de fait n’a cru ni à l’art moderne, ni à l’art contemporain, ni à la vidéo, ni à la performance (5) ».
Finalement, il s’agit d’un argument facile. En se basant sur le statut du numérique, il constate que tout est numérique aujourd’hui. Dans le « tout numérique », non seulement nos vies sont filtrées par les médias numériques, mais tous les arts se sont numérisés, tous les artistes travaillent avec le numérique. Donc, plus de place, plus de sens pour un art dit numérique – car tout art est finalement numérique.
En même temps, Maniglier envisage l’option d’un art dont le but spécifique serait d’explorer ce passage, ce « devenir numérique du monde » et donc aussi de l’art, de « questionner cette passe ontologique ». Le numérique ne serait alors pas l’objet ni le médium ni même le code, mais le sujet de l’art.
Ce qui est frappant dans les déclarations de mort qui se multiplient à partir de 2004, c’est qu’elles viennent souvent de l’intérieur du monde de l’art numérique, de ceux qui s’étaient battus – comme moi – pour en défendre la naissance ou la survie. Je pourrais multiplier les témoignages en ce sens.
Une déclaration qui a fait époque est celle, publiée dans Rhizome déjà en 1996, de Lev Manovich dans The Death of Computer Art (6). Dans ce texte, d’un schématisme caricatural (bien entendu, intentionnel), Manovich prévoit que la convergence « between the art world and the computer art world » n’aura pas lieu, et présente, en résonance avec Disneyland, d’un côté Duchamp-land, c’est-à-dire le monde des galeries, des revues, des foires d’art contemporain, et de l’autre Turing-land, le monde de l’art numérique, avec ses galeries, ses revues, ses événements comme ISEA, Ars Electronica ou SIGGRAPH. Deux territoires en opposition.
Chaque territoire a ses règles.
L’objet typique de Duchamp-land est orienté vers le contenu, « compliqué », ironique, autoréférentiel, critique vis-à-vis des techniques que lui-même utilise. Alors qu’à Turing-land, c’est l’opposé : l’objet est orienté vers la technologie de pointe, « simple », sans ironie, et surtout, il prend la technologie qu’il emploie au sérieux. Dans Duchamp-land, l’accident technique est recherché, provoqué même (pensez à l’œuvre comme un « précipité du hasard », selon les termes de Duchamp), alors que dans Turing-land, comme dans l’industrie informatique, il est évité soigneusement. Si l’ordinateur crashe, c’est une catastrophe à Turing-land, alors qu’à Duchamp-land, c’est le signe du succès du processus...
La différence entre les deux milieux n’est donc pas dans l’utilisation de la technologie, mais dans l’attitude vis-à-vis de la technologie : on y croit, on n’y croit pas.
La même année, Nicolas Bourriaud, dans son pamphlet Esthétique relationnelle, avait radicalisé cette opposition en la transformant en loi, une « loi de délocalisation ». Je cite : « L’art n’exerce son devoir critique vis-à-vis de la technique qu’à partir du moment où il en déplace les enjeux : ainsi les principaux effets de la révolution informatique sont-ils aujourd’hui visibles chez les artistes qui n’utilisent pas l’ordinateur. Au contraire, ceux qui produisent des images dites "infographiques", manipulant les fractals ou les images de synthèse, tombent généralement dans le piège de l’illustration : leur travail n’est, au mieux, que du symptôme ou du gadget, ou, pire encore, la représentation d’une aliénation symbolique au médium informatique et celle de leur propre aliénation vis-à-vis des modes imposés de production. Ainsi la fonction de représentation se joue-t-elle dans les comportements : il ne s’agit plus aujourd’hui de dépeindre de l’extérieur les conditions de production, mais d’en mettre en jeu la gestuelle, de décrypter les rapports sociaux qu’ils induisent. » En synthèse, pour Bourriaud, « la technologie n’a d’intérêt pour l’artiste que dans la mesure où il en met les effets en perspective, au lieu de la subir en tant qu’instrument idéologique (7) ».
III.
L’opposition de Manovich, relue à côté de celle de Bourriaud (qui, par ailleurs, reviendra sur son avis plus tard, notamment dans son livre Postproduction (8)), révèle un point important : plus qu’un clash entre deux milieux, il s’agit d’une opposition entre deux paradigmes : d’un côté un art qui croit dans la technologie qu’il utilise, de l’autre un art qui l’envisage du point de vue critique.
Cette opposition a une histoire ancienne, comme le « cas » Jack Burnham le démontre (9).
Sculpteur, théoricien et curateur, Burnham publie en 1968 Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of This Century (10), où il préconise l’émergence d’un art post-cinétique et cybernétique, un dépassement de la sculpture par des objets hybrides, qui feraient converger la machine et l’organique et qui « simuleraient littéralement la structure de la vie ». L’accueil que cette vision prophétique reçoit incarne bien le début de ce clivage entre l’enthousiasme des adeptes de la « révolution technologique » et le rejet indigné des techno-sceptiques. Dans ses écrits ultérieurs, Burnham revient sur sa position, grâce aussi à l’exposition Software qu’il réalisera en 1970 au Jewish Museum de New York, où il explore la superposition entre l’esthétique des systèmes de matrice cybernétique et le paradigme émergent de l’art conceptuel. La démarche de Burnham est originale, car elle s’impose de dépasser la perspective de l’art et de l’inclure dans l’horizon plus large des transformations de la culture face à la révolution informatique. L’approche de Burnham n’est pas illustrative ni didactique, mais vise l’identification d’un changement de paradigme : explorer la révolution informatique pas tant par ses objets, que par ses effets « sur la sensibilité individuelle et sociale ».
Mais, dans les années 1970, au moment où la situation politique s’enflamme, entre autres à cause de la guerre du Vietnam, l’approche cybernétique défendue par Burnham n’apparaît pas seulement comme un dispositif totalisant, mais aussi totalitaire, instituant, par le moyen de la maîtrise technologique, de nouvelles formes de contrôle social. Le front polémique s’étend et va de Marcuse à des artistes comme Mel Bochner ou Robert Smithson. Dans le domaine de l’art, s’opère un virage important, qui vise la réintroduction de la dimension sociale aussi dans les pratiques conceptuelles. L’attitude n’est plus la même : après le social turn, l’art prend de la distance par rapport aux sciences et aux technologies, et assume une posture qui n’est plus affirmative ou constatative, mais dubitative, en revendiquant une mission explicitement critique. C’est la voie que privilégie aussi Hans Haacke, grand allié de la première heure de Burnham, d’abord en déplaçant son attention vers les « systèmes sociaux », ensuite en attaquant « le système » avec ses œuvres politiquement engagées.
En synthèse, avec le passage aux années 1970, le changement de contexte est fatal : l’optimisme progressiste qui avait impulsé l’esthétique cybernétique de la fin des années 1960 apparaît révolu et suspect, l’alliance entre art et technologie est considérée comme un « mariage de convenance avec l’industrie », et les financements des entreprises qui avaient permis les premières expérimentations sont dénoncés comme les gages d’une complicité avec le pouvoir, incompatible avec la mission de l’art. Face au constat d’une séparation de plus en plus nette entre le paradigme conceptuel, sacralisé dans un milieu de l’art contemporain de plus en plus sanctuarisé et protectionniste, et celui de l’art technologique, ostracisé et de plus en plus crispé dans son opposition foncière au monde officiel de l’art, le repli de Burnham assume la forme amère d’une apostasie – comme le révèle son dernier texte, le poignant Art and Technology: The Panacea That Failed (1980) (11).
Dans ce texte, Burnham revient sur le projet de convergence entre art et technologie des années 1960 et essaie d’en expliquer la défaite. La question qu'il se pose est la suivante : « Pourquoi les seules expériences artistiques dans les domaines des technologies du XXe siècle qui ont eu du succès, ont à faire avec l’absurdité et la faillibilité des machines? » Et d’évoquer, comme exemple, la tradition de matrice Dada, peuplée de machines inutiles, dysfonctionnelles, subversives, de Picabia à Ernst, de Duchamp à Tinguely. En revanche, l’art technologique qui « se prend au sérieux », basé sur la « chimère » de l’innovation scientifique en tant qu’instrument omnipuissant d’émancipation illuministe, semble destiné à l’échec. Nous retrouvons les mêmes termes que Manovich utilisera presque 20 ans après.
Au-delà de certaines considérations plus circonstancielles, Burnham se demande si la raison du schisme entre art et technologie n’est pas de l’ordre d’une incompatibilité métaphysique, d’une « dissimilarité fondamentale en tant que systèmes de sémiose humaine ».
Au contraire de la pensée technique, le paradigme conceptuel, qui marque finalement le destin de l’art, en exprime une nature qui n’est pas disruptive mais déceptive ; en récusant toute possibilité d’évolution et de progrès, il ne cesse de rappeler « comme nous sommes dominés par nos illusions perceptuelles ». En devenant conceptuel, l’art semble s’engager dans une mission qui n’est plus progressive, ni régressive, mais réflexive, ou mieux, introspective.
Procédant par un jeu vertigineux de négations, l’art se fonde comme l’expérience d’une déception révélatrice de l’écart inexorable qui se creuse entre la pulsion originaire qui pousse l’homme à modéliser, à objectiver, à « systématiser » le réel et ce même réel qui, « systématiquement », y échappe. On le voit, on revient à l’idée que nous avons identifiée tout à l’heure : l’art technologique croit dans la technologie, et donc se trompe (mais se trompe en tant qu’art ou en tant que vision du monde?), et l’art contemporain, de matrice conceptuelle, n’y croit pas... Bref, la question n’est pas liée à la technique, ni aux médias, ni même aux frontières disciplinaires ; elle est plus profonde – il s’agit d’une question fondamentalement éthique.
Le « cas Burnham » est juste un cas, mais il révèle que, à bien regarder, le douloureux conflit était là du début. On pourrait multiplier les exemples historiques. Je mentionne seulement l’échange entre Robert Smithson et György Kepes – autour de la malheureuse Biennale de Sao Paulo de 1969. Smithson conteste l’optimisme de Kepes vis-à-vis de la science et la technologie qu’il considère « a sad parody of NASA » : « Technology promises a new kind of art, yet its very program excludes the artist from his own art. The optimism of technical progress results in political despair... If technology is to have any chance at all, it must become more self-critical. If one wants teamwork he should join the army. A panel called "What’s Wrong with Technological Art" might help (12). »
La question, confirme Smithson, n’est pas purement technique, ni même esthétique, mais politique, ou, encore plus profondément, morale.
IV.
« What’s Wrong With Technological Art? »
Finalement cette question a été reprise et discutée au New Museum de NY en 2012, en parallèle à l’exposition Ghosts in the Machine, avec Peggy Ahwesh, Heather Corcoran de Rhizome, et les historiens de l’art Judith Rodenbeck et Gloria Sutton (13).
Nous n’allons pas entrer dans les détails de ce débat, mais il est important de citer cette exposition parce qu’elle marque un rapprochement : le monde de l’art contemporain, avec ses curateurs, ses galeries et ses institutions, soudain s’intéresse à l’histoire de l’art technologique. Mais à l’envers, d’une certaine manière : l’idée est de reconstruire une contre-histoire, une histoire de l’art qui résiste aux progrès et aux dérives technologiques, d’un art anti-technologique.
Ghosts in the Machine est construite à partir d’une attitude qu’on pourrait définir comme archéologique. Dans ce contexte, sont reproduites des expositions entières, comme Man, Machine and Motion (1955) conçue par Richard Hamilton (14). Comme l’explique Massimiliano Gioni, le commissaire, Ghosts in the Machine « is conceived like a Wunderkammer, a cabinet of curiosities presenting a sequence of objects and artworks that are linked together by a web of references and associations, kinships and elective affinities, in the kind of surreal montage best suited to that "dream-like life" (15) » .
Cette déclaration sonne un peu comme une justification : elle révèle cette approche particulière qui se met en place, qui envisage l’histoire du rapport de l’homme avec la machine à partir d’un point de vue foncièrement antipositiviste et sceptique. Comme dans l’exposition que Gioni considère le précédent historique de Ghosts in the Machine, The Bachelor Machines, réalisée par Harald Szeemann en 1975, les machines sont des « machines célibataires » dans le projet d’un « musée des obsessions ». Il ne faut pas les prendre au sérieux, pas plus que leur effectivité. Par contre, il faut prendre au sérieux leurs effets – psychologiques, sociaux, politiques. Ainsi, Gioni reconnecte la vision fantasmatique de la machine célibataire, qui a toute une tradition dans l’art depuis Duchamp, au contexte actuel, en analysant une « dérive technologique » dont « l’onanisme global des social media constitue l’incarnation plus récente ». Les titres des sections de l’exposition sont indicatifs de cette perspective critique : Technology As Symptom / Technology As Dream.
Donc, non seulement il ne faut pas croire aux machines et aux technologies, mais il faut relire l’histoire de l’art technologique comme une histoire critique, comme un rêve, comme un égarement tragique, comme une dérive.
Plusieurs expositions reprennent aujourd’hui ce point de vue, en associant la croyance dans la technologie à d’autres naïvetés – en explorant les rapports entre télé-présence et télépathie, l’écoute des voix des morts, la magie... Pour revenir à Burnham : de la technologie et d’autres mythes. Je pense par exemple au travail curatorial, passionné et passionnant, de Sébastien Pluot et Fabien Vallos sur une réactivation critique d’Art by Telephone, l’exposition du Museum of Contemporary Art de Chicago de 1969 (Art by Telephone... Recalled, La Panacée, 2014) (16), aux recherches d’historiens de l’art comme Arnauld Pierre et Pascal Rousseau, ou encore au projet Média Médiums, concocté par les artistes et chercheurs Gwenola Wagon et Jeff Guess (17).
V.
Mais nous ne pouvons pas discuter de la mort de l’art numérique sans citer le texte polémique que Claire Bishop a publié sur Artforum en 2012, dans le numéro anniversaire consacré aux rapports entre l’art et les médias (cette publication est d’ailleurs un autre symptôme du rapprochement dont je parle).
Dans « Digital Divide », Bishop se demande : « Whatever happened to digital art? (...) why do I have a sense that the appearance and content of contemporary art have been curiously unresponsive to the total upheaval in our labor and leisure inaugurated by the digital revolution? While many artists use digital technology, how many really confront the question of what it means to think, see, and filter affect through the digital (18) » et rétorque que non seulement le digital art est un ghetto, mais aussi l’art contemporain.
Quaranta rappelle que dans les années 1960, la décision d’ajouter un préfixe à des tendances expérimentales de l’art constituait une stratégie de survie, d’opposition à la vulgate moderniste ; c’était une pratique qui avait la fonction de manifeste. Cela a été le cas aussi du net art qui, selon Quaranta, a été capable de faire le pont entre Duchamp-land et Turing-land. Le chercheur italien conclut que le New Media Art doit être pensé comme un no man’s land pour l’expérimentation, une arène multidisciplinaire de recherche, libre des logiques du marché, un chantier stimulant pour la production de formes d’art qui ne se conforment pas aux normes – bref, comme un « incubateur d’instabilité ». Je cite : « New Media Art world can potentially generate the energy that powers the other art worlds, giving their respective “ideas of art” a radical evolution (19). »
Pour Quaranta, le New Media Art peut perdre aujourd’hui son préfixe, parce que nous entrons dans une condition « post-média ». Cette notion a une tradition, de Guattari à José Luis Brea, de Rosalind Krauss à Manovich. En 2005, Peter Weibel a organisé une exposition avec le titre Postmedia Condition. Cette notion indique une situation où les médias se sont généralisés, où l’expérience humaine, non seulement esthétique, est médiatisée, médiée par les médias. Dans la société post-médiale, dans le « tout numérique », on n’échappe pas aux médias ni au numérique. Cette généralisation du médiatique et du numérique peut paradoxalement émanciper l’art du déterminisme technologique et médiatique. On revient au même point évoqué au début de cette présentation.
Cette considération nous conduit à une autre réponse au pamphlet de Bishop, celle de la curatrice Sarah Cook, co-auteur de Rethinking Curating: Art after New Media (20), qui reformule de cette manière la question de départ : « [W]hy does contemporary art ignore our digital condition? »
Cook semble insinuer que ce sont les critiques d’art contemporain, les curateurs – et pas le milieu, généraliste, de l’art contemporain – qui sont ignorants et méprisants vis-à-vis des expérimentations technologiques. Cook relie l’ignorance de Bishop (pas tant de l’histoire des technologies, mais de leur fonctionnement, des notions de code ou d’interaction) à un préjugé enraciné, et se lance dans l’exercice de réécriture de l’essai de Bishop, en changeant systématiquement les exemples donnés. Je vous invite à lire cette intervention, très documentée. Finalement, Cook ramène le conflit entre art contemporain et numérique aux conflits historiques entre modernisme et avant-garde, à la question d’une vision innovante ou rétrograde – non seulement de l’art, mais de la société. Elle se demande si c’est l’art numérique qui est « ringard » ou l’art contemporain qui est conservateur et moraliste, et semble montrer des symptômes d’obsolescence. Bref, pour Cook, ce qui compte pour l’art numérique n’est pas d’être inclus dans les frontières du monde de l’art contemporain, mais d’être capable de modifier ces frontières. Elle cite le titre d’un texte de Cory Arcangel : « My art world is bigger than your art world »...
VI.
J’arrive à la fin de mon parcours. Bien évidemment, nous n’arrivons pas à une conclusion. Il n’y a pas de réponse à la question de départ. Le conflit – entre art et art numérique – perdure, parce que finalement il profite à certains. Cet écart, cette différence demeure profitable ou au moins opératoire, dans certains cas, très concrètement. Il est clair que certains acteurs du monde culturel ont besoin de cette notion d’art numérique – que ce soit pour déterminer une niche de marché, une spécialisation professionnelle, une spécificité créative, ou simplement pour identifier un sujet d’étude...
Ce clivage est donc utile, il répond à des logiques utilitaires.
D’autres acteurs poussent pour l’abolir, des artistes ou curateurs qui revendiquent une reconnaissance du monde de l’art mainstream, des théoriciens apostats qui se sentent à l’étroit dans le ghetto qu’ils ont contribué à créer... Bref, il n’y a pas de solution. Justement parce que, comme je l’ai dit au début, non seulement le monde de la pratique est compliqué, mais aussi la théorie est un théâtre de frontières, de positions et oppositions – ou, si l’on veut utiliser le vocabulaire belliciste des avant-gardes, un front de bataille.
Comme la position du galeriste, de l’artiste, du curateur, la position de l’historien de l’art dessine aussi à la fois une fiction, un récit qui oriente l’espace, et un projet qui oriente le temps. À moi, l’art numérique sert pour nommer des oppositions dans le théâtre des frontières que j’essaie de dessiner. Les déclarations sur sa mort me permettent de parler de la vitalité de l’art. Mais je m’arrête ici.
L’art numérique est mort, vive l’art.
Emanuele Quinz © 2016 FDL
(1) http://www.editions-hyx.com/fr/tous-nos-livres
(2) Emanuele Quinz, Le cercle invisible. Environnements, Systèmes, Dispositifs, Dijon, Les presses du réel, 2017, à paraître.
(3) http://chatonsky.net/indifference_art_0_/
(4) Ibid
(5) Patrice Maniglier, « L’art numérique n’a pas eu lieu », l’art dans tout le numérique, artpress2, no 29, mai-juin-juillet 2013.
(6) https://rhizome.org/community/41703/
(7) Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 1998, p. 69-70.
(8) Ibid
(9) Je renvoie à mon essai Conceptual Focus, in Jack Burnham et Hans Haacke, Esthétique des systèmes, sous la direction d’Emanuele Quinz, Dijon, Les presses du réel, 2015.
(10) Jack Burnham, Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of This Century, New York, George Braziller, 1968.
(11) Jack Burnham, « Art and Technology: the Panacea that Failed », in Kathleen Woodward (éd.), The Myths of Information: Technology and Postindustrial Culture, Madison, Coda Press, 1980, republié in John Hanhardt (éd.), Video Culture, New York, Visual Studies Worskhop Press, 1986, p. 232-248.
(12) Cit. par Reinhold Martin, « Organicism’s Other », in A. Picon, A. Ponte (éd.), Architecture and Tthe Sciences: Exchanging Metaphors, Princeton Architectural Press, p. 180.
(13) http://www.newmuseum.org/calendar/view/35/panel-discussion-what-s-wrong-with-technol...
(14) http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ghosts-in-the-machine
(15) Massimiliano Gioni, « Of Ghosts and Machines », in Ghosts in the Machine, catalogue de l’expositon, New York, New Museum, 2013, p. 9.
(16) http://www.artbytelephone.com
(17) http://www.mediamediums.net
(18) Claire Bishop, « Digital Divide », Artforum, no. 51, sSeptembre 2012.
(19) D’ailleurs, Quaranta utilise les mêmes termes qu’avait utilisés Margot Lovejoy dans, Post-modern Currents, Art and artists in Electronic Age, 1982, Prentice Hall College, 2e éd., 1996.
(20) Beryl Graham et, Sarah Cook, Rethinking Curating : Art after New Media, Cambridge MA, The Mit MIT Press, 2010.
Table des matières :
- Un art contemporain numérique
• Introduction
• Avant-propos
• Sommaire
• Exposition - Conservation
• Sara Diamond
• Étienne Grenier
• Jean-Pierre Gauthier
• Emmanuel Guez - Diffusion
• Emanuele Quinz
• Claudine Hubert
• Adam Basanta - Marché
• Pau Waelder
• Dominique Moulon
• Wolf Lieser
• Bernard Lamarche
• François Rochon
• Isabelle Riendeau